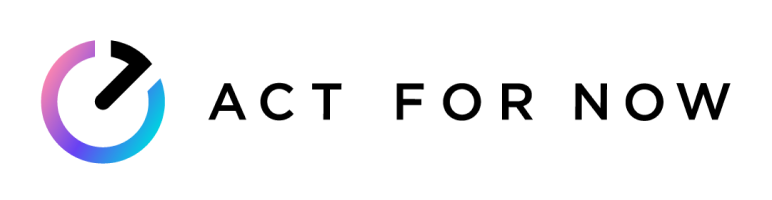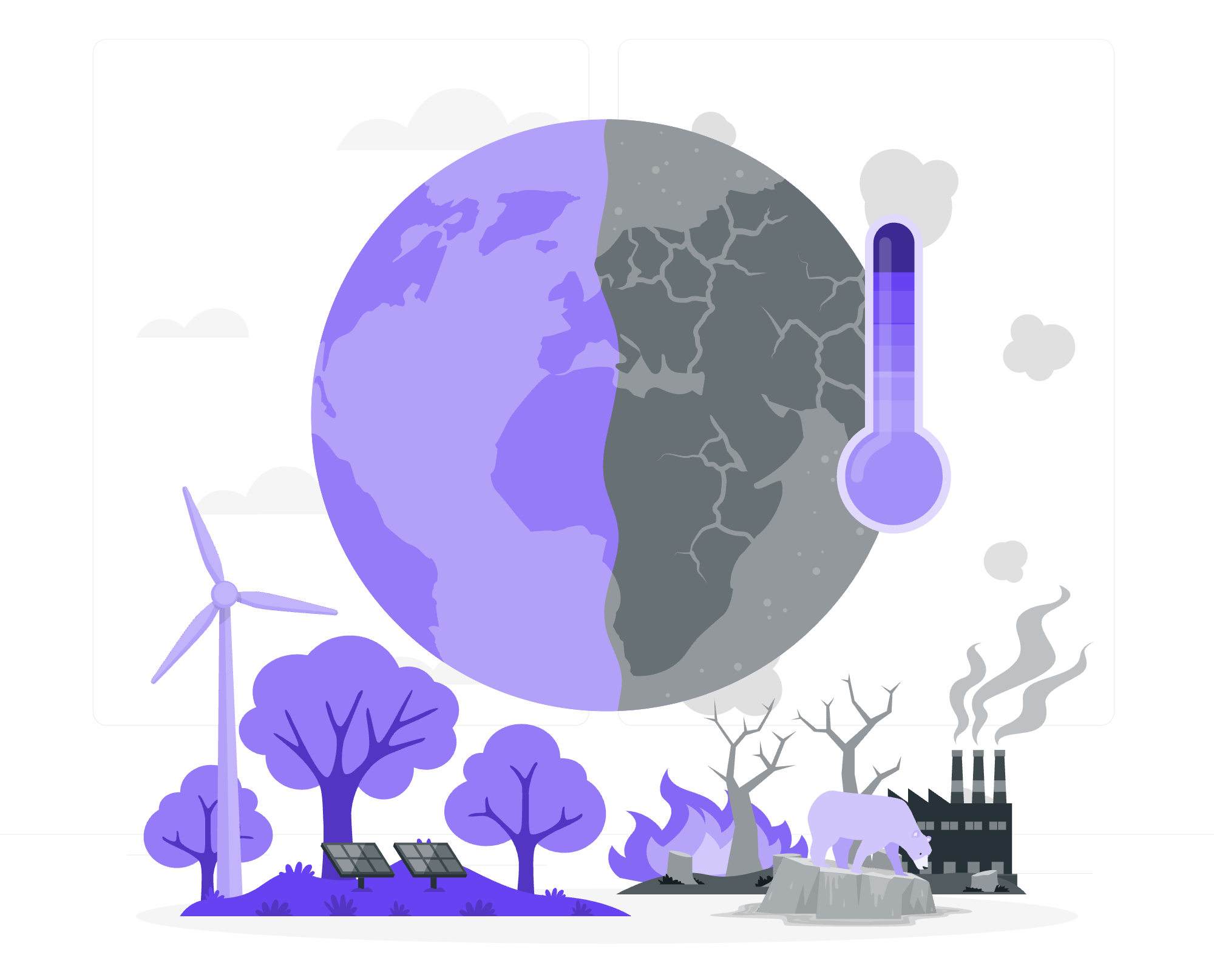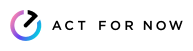Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Veille RSE : édition de juillet 2025
Publié le 23 juillet 2025
Juillet 2025 : tensions climatiques, sursauts citoyens et ajustements réglementaires
Alors que la canicule meurtrière du début d’été souligne une fois de plus l’urgence climatique, ce mois de juillet a aussi été marqué par de fortes mobilisations citoyennes, des arbitrages réglementaires controversés et de nouvelles dynamiques européennes vers la circularité. Voici les principaux signaux faibles et forts à suivre.
Climat : des extrêmes qui s’installent et deviennent la norme
Vagues de chaleur et mortalité accrue
Selon une étude du World Weather Attribution, la vague de chaleur survenue en Europe entre le 23 juin et le 2 juillet 2025 a causé environ 2 300 décès dans 12 villes, dont 1 500 (soit 65%) d’entre eux sont directement attribuables au changement climatique qui a amplifié l’événement de +2 à +4°C.
Madrid est la plus exposée, avec 108 des 118 décès liés à la canicule imputables aux dérèglements climatiques. La majorité des victimes, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans (88%), sont décédés à domicile ou à l’hôpital, des drames souvent invisibles et non signalés comme liés à la chaleur. Juin 2025 fut le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Europe de l’Ouest, avec des pointes allant de 40°C à 46°C (source : novethic.fr).
Réglementations : mobilisation citoyenne, ambitions et assouplissements

Un million de voix contre l’inaction
La pétition lancée le 10 juillet par une étudiante de 23 ans, Éléonore Pattery, contre la loi Duplomb a atteint presque 2 million de signatures en à peine quelques jours, un record historique pour la plateforme de l’Assemblée nationale, dépassant largement les précédents sommets et s’approchant du nombre de signataires de l’Affaire du siècle (2,3 millions). Alimentée par un puissant élan sur les réseaux sociaux, relayée par des activistes et personnalités comme Pierre Niney ou Camille Etienne, cette mobilisation reflète un raz‑de‑marée citoyen contre les reculs environnementaux apportés par la loi : réautorisation de néonicotinoïdes, facilitation des mégabassines, affaiblissement des consultations publiques.
Si le seuil des 500 000 signatures ouvre la possibilité d’un débat public à l’Assemblée, il n’entraîne aucun retrait automatique du texte, même si la présidente de l’Assemblée s’est déclarée favorable à ce débat à la rentrée parlementaire en septembre prochain (source : vert.eco).
Déforestation, une loi affaiblie sous pression
Le Règlement Européen sur la Déforestation (EUDR – EU Deforestation Regulation) impose aux entreprises une traçabilité précise (géolocalisation, vérification juridique) pour garantir que les produits qu’elles commercialisent ne contribuent pas à la destruction des forêts : diligence renforcée, contrôles selon le degré de risque, et sanctions dissuasives pour non‑conformité. Ce règlement européen anti-déforestation, qui devait entrer en vigueur en décembre et cibler les importations de cacao, café, soja, huile de palme, bois ou caoutchouc, est remis en question après l’adoption d’une motion au Parlement européen visant à créer une catégorie « sans risque » dispensant certains pays d’obligation de géolocalisation ou de contrôles minimaux.
Dix-huit États membres (hors France, Allemagne et Espagne) demandent aussi des ajustements, craignant un désavantage concurrentiel pour leurs producteurs.
Les ONG alertent que ceci pourrait ouvrir des passoires réglementaires sous couvert de simplification (notamment sur le blanchiment de produits comme le bouleau illégal venant de Russie ou Biélorussie), encouragent la Commission à ne pas rouvrir le texte, et considèrent que le message du Parlement est un avertissement fort, sans valeur contraignante pour l’instant (source : novethic.fr).
Vers un futur zéro déchet
En Europe, la Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) vise à réduire et prévenir la production de déchets d’emballages, en favorisant le recyclage, la réutilisation et l’utilisation de matières recyclées. Ce règlement est entré en vigueur le 11 février 2025 et sera pleinement applicable à partir du 12 août 2026, sans transposition nationale.
- Recyclabilité : tous les emballages doivent obtenir une note minimum de Grade C (≥ 70 % de recyclabilité) d’ici le 1er janvier 2030. Puis Grade B (≥ 80 %) d’ici 2038.
- Contenu recyclé : niveau minimum fixé pour les plastiques (ex 30 % pour bouteilles PET) dès 2030, à renforcer en 2040.
- Éco-conception : limitation du poids, volume et espace vide (≤ 50 % d’espace vide), interdiction d’emballages trompeurs (double paroi, vidéos).
- Réutilisation et remplissage : obligation de systèmes de consigne, de réemploi et de remplir dans les restaurations avec ses contenants sans frais supplémentaires.
- Interdiction progressive de certains emballages à usage unique (ex. fruits & légumes <1,5 kg, sachets de condiments, films de regroupement) à partir de 2030.
- Limitation stricte des substances néfastes (PFAS, métaux lourds) dans les emballages en contact alimentaire, valables dès août 2026.
En bref, un tournant radical vers l’économie circulaire : éco-conception, recyclabilité minimale, réemploi, contenu recyclé, restrictions des formats à usage unique et substances nocives. L’objectif : zéro déchet non recyclable d’ici 2030 et harmonisation légale à l’échelle européenne (source : environment.ec.europa.eu).
Reporting : frein ou révélateur de performance ?
Les dernières annonces de l’EFRAG
Les entreprises de la première vague dites wave one (grandes structures soumises à la CSRD dès 2024) bénéficient d’un report jusqu’à la fin de l’exercice 2026 pour :
- Biodiversité et écosystèmes (ESRS E4)
- Travailleurs dans la chaîne de valeur (ESRS S2)
- Communautés affectées, consommateurs & utilisateurs finaux (ESRS S3/S4)
- Émissions de Scope 3
Mais pourquoi ce report ?
- Réduction du fardeau administratif : pour donner le temps de produire des données précises, en particulier sur les Supply chains et les impacts écologiques/ sociaux difficiles à chiffrer rapidement.
- Cohérence du paquet Omnibus : ces réajustements s’inscrivent dans une volonté politique plus large de simplification (source : efrag.org).
La CSRD, moteur des entreprises à mission
La Communauté des entreprises à mission, aujourd’hui rassemblant plus de 2100 structures et un million de salariés, défend une vision proactive du reporting CSRD : pour elles, ce n’est pas une contrainte mais un levier stratégique. Inscrite dans leurs statuts, la mission oriente et donne du sens au reporting, tandis que ce dernier assure rigueur et pilotage opérationnel ; le tout inscrit dans la gouvernance au plus haut niveau.
Loin du simple exercice formel, cette synergie mission‑reporting renforce la transformation durable, favorise la cohérence en période d’évolution réglementaire et instaure une confiance pérenne auprès des parties prenantes, car ces entreprises savent pourquoi elles agissent et comment progresser (source : Tribune dans novethic.fr).
Entreprises françaises : vers des préoccupations plus sociales

Du climat aux conditions humaines
- Globalement, les AG 2025 ont été moins mouvementées que les années précédentes, avec peu d’interruptions, de manifestations ou de batailles sur les résolutions climatiques.
- Bien que l’atmosphère fût sage, les sujets extra-financiers (en particulier le climat) ont occupé une place centrale.
- C’était notamment la première année de mise en œuvre de la CSRD, poussant les entreprises à aller au‑delà des obligations minimales dans leurs stratégies ESG.
- Les investisseurs entendent questionner les entreprises du CAC 40 sur le niveau de vie décent de leurs employés et de leurs sous-traitants/fournisseurs.
- Cette dynamique traduit une volonté de construction d’un modèle économique plus éthique, globalement aligné avec les principes de durabilité et de justice (source : novethic.fr).
Marie Marchais (Responsable Engagement du Forum pour l’Investissement Responsable) a déclaré : « Le backlash sur le climat force encore davantage à inclure les enjeux sociaux dans les politiques environnementales, pour qu’elles soient acceptées par le plus grand nombre. »
État des lieux des entreprises françaises
Le réseau France du Pacte mondial des Nations Unies a publié une étude sur l’engagement des entreprises françaises en matière de discrimination, égalité de genre, climat… On vous résume :
Actions sur l’égalité de genre :
- Inégalités avec le reste du monde : 77% des entreprises françaises ont engagé des actions (contre 86 % mondiales).
- Formations aux droits des femmes : seulement 41% en France, contre 58% en Europe et 71% dans le reste du monde.
- Absence de formation : 31% des Françaises n’en proposent aucune, contre 20% en Europe et 12% ailleurs dans le monde.
Domaines où la France reste en retrait :
- Gestion de l’eau : seulement 50%, contre 57% en Europe et 68% monde.
- Biodiversité : 47% des entreprises françaises, comparé à 48% en Europe et 56% dans le reste du monde.
- Océans : 21% en France, 26% en Europe et 33% monde.
Les entreprises françaises adhérentes montrent donc de solides engagements en matière de RSE, notamment sur la santé, la sécurité et l’environnement, mais elles accusent un retard relativement significatif dans les actions concrètes en faveur de l’égalité de genre (formation, sensibilisation) et sur certains volets écologiques comme la gestion de l’eau, la biodiversité et la protection des océans, comparativement à leurs homologues mondiales (source : carenews.com).
Nos experts

- Marine BAILLY
- Consultante et responsable formations